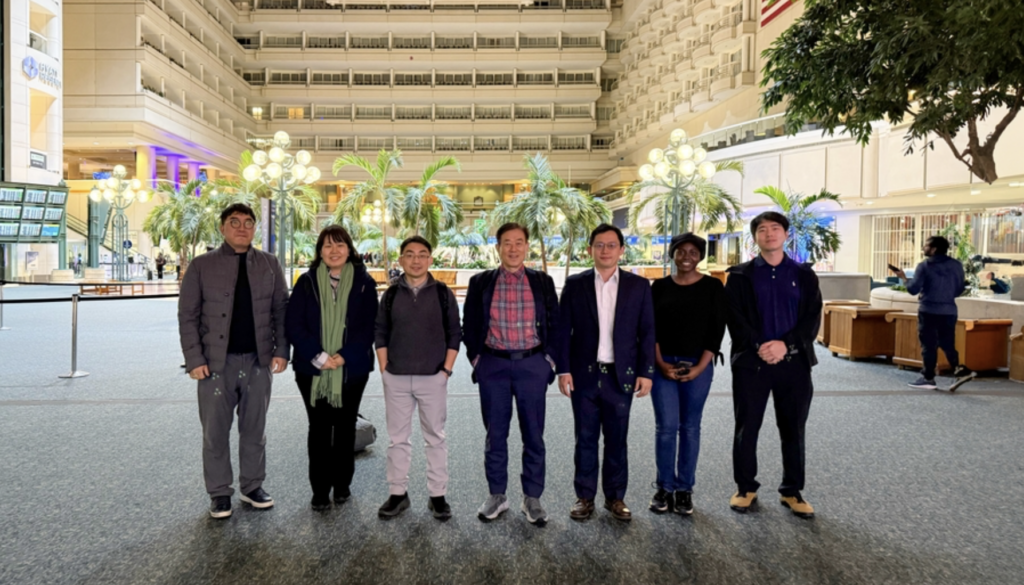
1. Diversité des perspectives dans l’Église et l’exhortation de l’apôtre : « Ne jugez pas votre frère »
Le chapitre 14 de l’Épître aux Romains est un texte essentiel qui montre de manière concrète comment vivre ensemble dans la communauté chrétienne lorsque s’y rencontrent des personnes aux opinions et points de vue différents. Dans ce passage, Paul s’adresse aux croyants de l’Église de Rome en leur transmettant ce message central : « Ne vous jugez pas les uns les autres, mais acceptez-vous mutuellement dans le Seigneur. » En particulier, dans la première partie (Rm 14.1-12), il insiste sur l’idée de ne pas critiquer celui dont la foi est « faible ». C’était un conseil empreint d’amour et de sagesse pratique, visant à surmonter les conflits existant dans l’Église primitive. Cette recommandation, qui a continué d’être un sujet majeur tout au long de l’histoire de l’Église, s’applique tout autant à nos communautés actuelles. Le pasteur David Jang, lui aussi, s’appuyant sur l’enseignement de Paul, souligne qu’il importe de résoudre les divers conflits internes ou externes à l’Église dans l’esprit de l’Évangile. Alors que l’Église contemporaine parle de « communion et d’unité », elle fait pourtant face à d’innombrables divisions, grandes ou petites. Dans ce contexte, « ne pas critiquer mais accepter l’autre » demeure un défi fondamental et toujours d’actualité.
Paul désigne deux groupes dans l’Église de Rome : les « faibles » et les « forts ». Plutôt que de les qualifier de « croyants d’origine juive » et de « croyants d’origine païenne », il parle de la force ou de la faiblesse de leur foi. Les « faibles », c’est-à-dire ceux dont la foi est dite fragile, sont ceux qui respectent scrupuleusement la Loi et les règles alimentaires. À l’inverse, les « forts » jouissent d’une plus grande liberté dans l’Évangile et ne se sentent pas liés par des règles alimentaires ou la stricte observance de certains jours. Le conflit entre ces deux groupes portait sur la question de la nourriture et de l’observance des jours spéciaux. Les croyants d’origine juive, attachés aux lois de pureté, refusaient de consommer toute nourriture jugée « impure ». Paul qualifie ces personnes de « faibles ». Les croyants d’origine païenne, eux, mangeaient et buvaient librement, y compris de la viande sacrificielle ou du porc. Paul les nomme « forts ».
Cette classification reflète la théologie profonde de Paul. Il n’a cessé de rappeler que la liberté, lorsqu’elle ne tient pas compte de la conscience ou de la foi d’autrui, peut devenir un péché. C’est une perspective qui rejoint aussi la prédication du pasteur David Jang : l’Évangile nous offre un don merveilleux, la « liberté », mais cette liberté doit être contenue par l’amour. Parfois, pour le bien de l’autre, il faut être prêt à mettre une limite à cette liberté. Au final, Paul encourage les « forts » comme les « faibles » à renoncer à l’affirmation exclusive de leur propre raison pour s’efforcer plutôt de comprendre et de respecter les différences de chacun, contribuant ainsi à édifier le corps du Christ. Pour lui, c’est dans cet esprit d’unité évangélique que tous les croyants doivent avancer.
Dès le premier verset de Romains 14, Paul déclare : « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » C’est là une instruction directe sur l’attitude à adopter en cas de conflit dans l’Église, en particulier pour ceux qui se considèrent comme « forts ». Puis Paul constate : « Tel croit pouvoir manger de tout ; tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes » (14.2). Paul décrit ainsi la coexistence de ces deux attitudes. L’essentiel, c’est qu’il reconnaît que les uns comme les autres agissent « pour le Seigneur » : celui qui mange et celui qui s’abstient (14.6). Autrement dit, ni l’observance de certaines règles alimentaires ni la célébration de jours particuliers ne constituent le cœur de la foi. Dans le conservatisme religieux, on s’imagine parfois être le seul à « détenir la vraie foi », tandis que dans le libéralisme, on peut penser détenir la « liberté authentique de l’Évangile ». Mais Paul insiste : tant que chacun estime agir « pour Dieu », on ne doit pas se juger mutuellement. Dieu seul connaît la réelle profondeur de la foi de chacun. « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d’autrui ? » (14.4) exprime parfaitement cette idée : tous les croyants sont des serviteurs du même Seigneur ; or, un serviteur ne saurait juger un autre serviteur.
Le pasteur David Jang répète souvent dans ses prédications et conférences que « seul Dieu a le droit de juger ». Au moment même où l’Église, à la manière du monde, tente de discerner « qui a raison, qui a la foi la plus sincère », elle risque déjà de s’éloigner de l’essence de l’Évangile. Ce n’est que lorsque nous nous accueillons mutuellement sans critique, et lorsque nous choisissons l’amour plutôt que la suspicion, que la paix, la joie et la justice peuvent véritablement régner dans l’Église. Les paroles de Jésus, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés » (Mt 7.1-2), constituent forcément le critère principal pour régler les conflits internes. Dans cette même logique, Paul invite chacun à agir « dans le Seigneur » tout en veillant à ne pas faire tomber son frère. Cette préoccupation est particulièrement flagrante dans 1 Corinthiens 8 et 10, où Paul aborde les aliments sacrifiés aux idoles : il juge plus important de préserver la foi de l’autre que de défendre à tout prix sa liberté personnelle. C’est donc à la promotion de l’harmonie et de l’amour que sont appelés les croyants, plutôt qu’à la discorde et au conflit.
Appliqué à la vie de l’Église d’aujourd’hui, cela concerne, par exemple, la différence de styles musicaux durant le culte, la manière d’administrer le baptême ou la Sainte-Cène, la question de respecter ou non certaines fêtes, etc. Souvent, ces divergences se situent dans le champ de ce qu’on appelle « adiaphora », c’est-à-dire des éléments ni absolument bons ni absolument mauvais. Paul incite à considérer si ces sujets relèvent vraiment de la substance de la foi (le salut, la rémission des péchés) ou non. S’ils ne touchent pas au cœur de la doctrine, les croyants doivent s’accueillir les uns les autres et agir avec amour, tout en se gardant de détruire la foi de l’autre par leurs agissements ou leurs paroles. En définitive, « l’édification » et « la paix » se construisent à partir d’un état d’esprit qui renonce à juger autrui. Avoir des doutes, mépriser ou humilier l’autre freine l’unité de l’Église. Pour Paul, nous appartenons tous au Seigneur, « vivants ou morts » (14.8), si bien qu’aucun de nous n’a le droit de mépriser ou de juger les autres.
Ainsi, l’enseignement de Paul dans Romains 14.1-12, et les paroles de Jésus dans le Sermon sur la Montagne – « Celui qui dira à son frère : ‘Raca’ méritera d’être puni par le sanhédrin… » (Mt 5.22), « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés » (Mt 7.1-2) – servent de fondements indispensables au fonctionnement d’une Église. Le pasteur David Jang souligne souvent que, si la culture du « jugement et de la condamnation » perdure au sein de l’Église, aucun renouveau ni aucun réveil ne sont envisageables. Seul le souvenir de l’amour dont Jésus nous a comblés peut nous amener à réaliser que nous devons absolument vivre en « paix » et en « harmonie ». Là où l’amour et la communion sont brisés, la foi se dissout rapidement. David Jang rappelle fréquemment que l’Église s’effondre moins sous la persécution ou la répression extérieure que sous l’effet des conflits et des jugements internes. C’est le message commun à Paul et au pasteur David Jang.
Paradoxalement, Romains 14 illustre la capacité de l’Église à embrasser des traditions et des cultures diverses. Les croyants d’origine juive tenaient à célébrer leurs fêtes, tandis que les païens convertis valorisaient parfois d’autres jours issus de leur culture. Mais Paul, loin de privilégier un camp, propose une vision inclusive : « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui ne les distingue pas agit aussi pour le Seigneur » (cf. Rm 14.6). Le point crucial, c’est la motivation qui inspire l’attitude de chacun : « Pour qui, et pourquoi le fait-on ? » L’Église doit apprendre la sagesse d’une telle diversité, en demeurant unie autour de l’Évangile et dans l’amour. L’esprit du Christ n’est pas celui de la critique ou du mépris, mais celui qui reconnaît les différences et chemine ensemble vers le Royaume.
2. Une pratique de foi pour ne pas faire tomber son frère : la « restriction par amour »
Dans la seconde partie de Romains 14 (v.13-23), Paul insiste sur un point complémentaire : « Ne soyez pas une pierre d’achoppement pour votre frère. » Après avoir incité tout le monde à accepter l’autre sans le juger (vv.1-12), il appelle désormais chacun à l’attention pratique : veiller à ce que sa propre liberté n’entraîne pas la chute ou la perte de foi de l’autre. Paul écrit au verset 13 : « Décidons plutôt de ne rien faire qui puisse être pour notre frère occasion de chute ou de scandale. » Même si nous avons le droit d’user de telle ou telle liberté, si notre comportement cause du tort à la foi de quelqu’un, nous devons savoir y renoncer au nom de l’amour.
C’est le concept d’« adiaphora » que Paul mobilise ici. Cela désigne des actions qui, en elles-mêmes, ne sont ni fondamentalement bonnes ni fondamentalement mauvaises, donc moralement « neutres ». Tout au long de l’histoire de l’Église, les croyants se sont affrontés sur d’innombrables sujets similaires : formes du culte, style de musique, codes vestimentaires, coutumes culturelles, etc. Selon les traditions, certains insistent sur la rigueur, d’autres sur la liberté ; toutefois, tous cherchent, en principe, à honorer l’Évangile, bien que par des méthodes différentes. C’est en ce sens que Paul écrit : « Rien n’est impur en soi ; mais si quelqu’un considère une chose comme impure, alors elle est impure pour lui » (14.14). Autrement dit, manger tel aliment n’est pas en soi un péché, mais si quelqu’un le vit comme un péché et qu’on le force malgré tout, ou si on le méprise pour son scrupule, alors le péché surgit de cette contrainte ou de ce jugement.
Dans ses prédications, le pasteur David Jang commente souvent ce passage en le résumant ainsi : « L’amour restreint notre liberté. » Ce qui est tout à fait bénin pour les uns peut provoquer un malaise ou un conflit de conscience chez les autres. Celui qui aime véritablement ne dira pas : « Allez, ce n’est pas grave, viens faire comme moi ! » Il préférera au contraire : « Même si ce n’est pas un problème pour moi, je respecterai ta sensibilité ; je n’en abuserai pas devant toi. » Dans 1 Corinthiens 8.13, Paul déclare de façon radicale : « Si je dois être occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande. » Il donne là un exemple extrême pour souligner que la liberté évangélique ne consiste pas à faire de sa liberté personnelle la priorité, mais à penser d’abord au « salut du frère ». Paul serait prêt à renoncer à ses droits et à sa liberté si cela peut préserver la foi d’autrui.
Au verset 15 de Romains 14, il dit : « Si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l’amour. » Cela illustre de manière dramatique combien imposer sa préférence ou négliger l’état spirituel de l’autre peut conduire ce dernier à la ruine, alors que le Christ a donné sa vie pour lui. Faire tomber son frère, c’est saper la portée sacrificielle de la mort du Christ. Ainsi, au sein de la communauté, les « forts » ont un devoir de bienveillance envers les « faibles ». Ici, être « fort » ne renvoie pas à un niveau de foi plus « élevé », mais à une plus grande marge de liberté dans l’Évangile. Or cette liberté ne doit pas être mal utilisée. Par exemple, si l’on fait face à quelqu’un qui ne peut pas manger de porc par conviction, lui dire : « Mais non, manger du porc n’est pas un péché, mange donc ! » revient potentiellement à le faire chuter. Aimer commence par la volonté de comprendre « comment l’autre le vit » et de tout mettre en œuvre pour ne pas l’offenser.
Qu’en est-il dans nos Églises actuelles ? Nous constatons une grande diversité de goûts, de tempéraments et d’expériences spirituelles. Certains acceptent volontiers certaines formes culturelles ou cultuelles, d’autres les rejettent catégoriquement. Bien que tous agissent « pour le Seigneur », il est inévitable que des tensions surgissent. La question cruciale devient alors : « Suis-je prêt, pour le bien de la paix et de l’unité de l’Église, à restreindre ma liberté ? » Au verset 19, Paul déclare : « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle. » Il exhorte ainsi les croyants à s’employer d’abord à la paix plutôt qu’à alimenter les disputes. La vocation de l’Église est de servir, dans l’unité d’un seul corps, l’extension du Royaume de Dieu, et non de se déchirer pour des questions secondaires de repas ou de boissons.
C’est dans cet esprit que Paul affirme : « Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (14.17). Il s’agit là du cœur du débat : on ne devrait ni attrister ses frères ni les exposer à la tentation, ni rompre la paix pour de simples questions d’ordre alimentaire ou rituel. Le pasteur David Jang, dans ses prédications, évoque souvent la restauration véritable du « shalom » : c’est dans la justice, la paix et la joie que s’incarne le Royaume de Dieu. Si l’Église se perd en disputes et en jugements autour des repas, des jours de fête ou d’autres domaines extérieurs, elle s’éloigne déjà de la nature même du Royaume. Ce que Paul souligne, c’est qu’il faut traiter avec sérieux toute question, même la plus insignifiante, si elle risque de faire trébucher un frère. L’amour prime la connaissance. Comme Paul l’écrit ailleurs : « Tout est permis, mais tout n’édifie pas » (1 Co 10.23) – la vérité qui doit être retenue.
Aux versets 20-21, il précise : « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s’abstenir de toute chose qui pourrait être pour ton frère une cause de chute. » Ainsi, même si la liberté est bonne en elle-même, il y a un bien supérieur : la préservation de la joie et du salut de son frère. Paul conclut au verset 23 : « Celui qui a des doutes à propos de ce qu’il mange est condamné s’il mange, parce qu’il n’agit pas par conviction. Or tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché. » Paul insiste sur l’importance d’agir « par la foi, la conscience au clair ». Et cette conscience inclut aussi la sensibilité spirituelle de l’autre. Si je peux faire quelque chose sans me sentir coupable, mais que cette attitude blesse la conscience de mon frère, Paul m’appelle à m’abstenir. L’amour du Christ ne se limite pas à moi ; il se déploie à toute la communauté.
C’est ce qui constitue l’éthique propre à la communauté chrétienne. Dans le monde, on entend souvent : « Pourquoi me préoccuper de ce qu’il ressent ? Chacun est libre ! » Mais dans l’Église, le principe est : « Nous sommes responsables les uns des autres. » Le pasteur David Jang appelle cela la « conscience communautaire de la Croix ». Pour l’Église qui se souvient du sacrifice du Christ, aimer et servir l’autre même à son propre détriment est un impératif. La situation de l’Église primitive, partagée entre la culture juive et la culture païenne, offre à l’Église contemporaine un modèle précieux pour gérer la diversité. Au sein de nos Églises, les antécédents culturels, l’histoire de la foi, les sensibilités théologiques sont multiples. Toutefois, si nous recherchons l’essence de l’Évangile et grandissons ensemble dans l’amour, la voie qui s’impose est de « restreindre notre liberté » lorsque c’est nécessaire, afin de préserver l’unité.
3. Service communautaire et large hospitalité : l’appel final à accueillir les païens
Dans Romains 15.1-13, Paul prolonge le sujet abordé au chapitre 14. Dès le premier verset, il déclare : « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Chacun doit porter les faiblesses de l’autre, incarnant concrètement l’amour de Christ. Pour mettre fin au cercle vicieux des suspicions mutuelles (les uns traitant les autres de « légalistes », et les autres leur reprochant un « laxisme »), Paul exhorte à « s’aider et s’édifier ». Le pasteur David Jang souligne également que le signe distinctif de l’Église, c’est la sollicitude envers les plus faibles. Lorsque l’Église rejette ou condamne les « faibles », elle se coupe du cœur même de l’enseignement du Christ. Jésus lui-même n’a pas cherché sa propre satisfaction, mais a donné sa vie pour nous pécheurs ; à présent, il nous incombe de mettre nos forces au service de ceux qui sont plus vulnérables – voilà l’assise théologique de Paul.
Au verset 4 et suivants, Paul précise : « Or tout ce qui a été écrit à l’avance l’a été pour notre instruction… » Et plus loin (v.5-6), il souhaite vivement que « le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les uns envers les autres les sentiments de Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule voix, vous glorifiiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il désire ardemment que, malgré leurs divisions, les croyants puissent louer d’une seule voix. Les temps changent, les conflits aussi, mais le rêve d’une Église qui parvient à glorifier Dieu d’un seul chœur demeure le même. Cette prière de Paul transcende les époques et résume la vision de l’Église.
À partir du verset 7, Paul en vient au point culminant : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Le conflit entre Juifs et païens convertis était la grande problématique ecclésiale de l’époque : les Juifs, fiers de leur héritage de la Loi, les Païens, sceptiques quant à ces observances. Paul, fort de son expérience, était bien conscient de l’ampleur de ces tensions. Pourtant, il ne cesse d’affirmer dans ses autres lettres (Éphésiens, Galates, Philippiens…) qu’en Christ il n’y a plus de distinction ; nous formons une « nouvelle créature ». De même, dans l’Épître aux Romains, il répète qu’il ne faut pas rejeter les Païens ni exclure les Juifs, mais les inviter à s’accueillir mutuellement.
Paul appuie cela sur la théologie de l’Ancien Testament et sur son accomplissement messianique. Les prophètes annonçaient la gloire de Dieu pour Israël mais aussi pour les nations. En Jésus-Christ, cette promesse s’est étendue à tous. Dieu a planifié une communauté unique, formée de Juifs et de non-Juifs, unis dans le salut. Paul le démontre en citant divers textes de l’Ancien Testament (Psaumes, Deutéronome, Ésaïe…) (Rm 15.9-12). L’Évangile n’est pas réservé à un peuple ou une culture, mais concerne toute l’humanité. L’Église doit donc cesser de mépriser ou d’exclure quiconque, pour embrasser une vision plus large. Paul conclut au verset 13 : « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Son souhait est que l’Évangile, loin de se limiter à la sphère individuelle, transforme toute l’Église, et même le monde.
Le pasteur David Jang va plus loin en remarquant que, dans le contexte actuel, l’Église doit être le lieu par excellence où se réunissent des personnes de toutes langues, races et cultures. Si l’Église s’enferme dans un style, une culture ou un milieu social précis, elle réduit la puissance unificatrice de l’Évangile. C’est pourquoi il nous faut nous interroger régulièrement : « Même si cela m’est inconfortable, puis-je me réjouir de ce qui réjouit l’autre ? » C’est la mise en pratique de Romains 15.2 : « Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, pour son bien, en vue de l’édification. » Les croyants venus d’autres cultures entrent parfois avec leurs langues et leurs mœurs, ce qui peut heurter ceux qui sont habitués à une tradition ancienne. Et vice-versa : les nouveaux venus peuvent trouver étouffants ces usages établis. Pourtant, l’Église doit accueillir ces deux pôles et leur apprendre à ne faire qu’un, dans le Christ.
Ce message de Romains 15 est en réalité la thématique majeure de l’ensemble des épîtres de Paul. Dans la perspective de la « dimension universelle » de l’Évangile, tous sont conviés, par l’amour de Dieu, à entrer dans l’unique Famille. Ce n’est pas un simple assemblage visible, mais une intégration profonde où Juifs et Païens, forts et faibles, conservateurs et progressistes se reconnaissent comme frères et sœurs. Paul sait que cette démarche suscite inévitablement des chocs culturels et des conflits. Mais il croit que la lumière de l’Évangile est capable de guérir ces affrontements et de faire naître la véritable communion.
Le pasteur David Jang rappelle souvent la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 : « Père, que ceux que tu m’as donnés soient un, comme toi et moi nous sommes un. » Si l’Église, au lieu de se diviser en d’incessantes querelles, manifeste vraiment l’accueil mutuel et l’unité, le monde s’en trouvera interpellé et glorifiera Dieu. A contrario, si l’Église se perd dans ses divisions et son esprit critique, on lui reprochera sa contradiction : « Comment voulez-vous annoncer l’Évangile alors même que vous n’êtes pas unis ? » Paul avertit dans Romains 14.16 : « Que votre privilège ne devienne pas un sujet de calomnie. » Il met les croyants en garde contre le risque de fournir au monde un prétexte pour discréditer l’Église. Cette mise en garde était urgente il y a deux mille ans et demeure urgente aujourd’hui.
En conclusion, l’enseignement de Paul dans Romains 14-15 offre un guide précieux pour l’Église d’aujourd’hui. Premièrement, face à la diversité culturelle et spirituelle, « ne vous jugez pas les uns les autres », ne vous méprisez pas et ne vous soupçonnez pas. Deuxièmement, si le croyant jouit de la « liberté » en Christ, il doit savoir la restreindre quand la foi de l’autre est en danger – c’est l’« offrande d’amour » que nous sommes appelés à faire. Troisièmement, chacun doit suivre l’exemple du Christ qui s’est sacrifié pour nous : porter les fardeaux des faibles, accueillir l’autre, y compris l’étranger, afin que Dieu soit glorifié. Selon le pasteur David Jang, c’est là le fondement permanent de l’Évangile, le point de départ de tout travail d’Église et son aboutissement.
Si nous prenons au sérieux ces exhortations de Romains 14-15, la communauté chrétienne ressemble alors à un vaste pâturage où diverses espèces cohabitent en harmonie. Dans la savane, même le lion, pourtant le plus fort, peut s’écrouler s’il est malade ou affaibli. Il en va de même pour l’Église : elle n’est pas seulement menacée par les persécutions extérieures, mais aussi par les disputes internes et les critiques mutuelles. Pour éviter de s’autodétruire, nous devons choisir de protéger, au lieu de condamner, ceux qui nous semblent différents ou faibles. C’est ainsi que nous parvenons à la « justice, la paix et la joie » ; ainsi, Dieu étend la Bonne Nouvelle à travers une Église qui demeure unie.
Parmi les exemples que cite souvent le pasteur David Jang, il y a celui d’un parent qui voit ses enfants se disputer. Le parent n’en privilégie aucun, car il aime chacun ; il souhaite qu’ils se réconcilient. Dans l’Église, Dieu agit de même : nous sommes tous ses enfants, et Il nous dit : « Cessez de vous juger et de vous mépriser, mais honorez-vous les uns les autres. » Mettre en pratique cela, c’est ressembler à Jésus-Christ et rendre gloire à Dieu. Même si les controverses d’aujourd’hui, que ce soit entre courants théologiques, confessions, cultures ou générations, sont différentes de celles concernant l’observance des jours et la nourriture, le principe demeure le même. Bien loin de n’être qu’une histoire ancienne, le commandement de Paul : « Accueillez-vous les uns les autres » est toujours d’une nécessité absolue.
Enfin, dans Romains 15.13, Paul prononce une bénédiction : « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » La vie chrétienne n’est pas de fuir les conflits ni de composer en tout, mais de laisser la puissance de l’Évangile transformer et engloutir tout conflit pour finalement en faire jaillir la joie et la paix. Lorsque l’Église ne vit ni cette joie ni cette paix, peut-être est-ce le signe qu’elle tolère en son sein un « esprit de critique, de méfiance et de mépris ». C’est seulement en revenant à l’enseignement de Paul et à l’appel récurrent du pasteur David Jang (« Aimez-vous et acceptez-vous mutuellement ») que l’Église peut espérer réaliser cette « unité dans la diversité ». Une Église ainsi unie poussera le monde à glorifier Dieu, et les âmes abattues y trouveront une lumière de guérison et de réconciliation.
Même avec deux mille ans d’écart, l’essentiel de l’Évangile demeure identique : au lieu de juger notre frère, nous devons l’accueillir, jouir d’une liberté responsable et aimante, et nous soucier de ceux qui sont dans la faiblesse, y compris des étrangers, pour la gloire de Dieu. Voilà ce que signifie se souvenir que « nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu » (Rm 14.10). L’Église ne goûte réellement à la « justice, la paix et la joie » que lorsqu’elle choisit l’accueil et l’amour mutuels, plutôt que la critique et la division. C’est là, répète le pasteur David Jang, le pivot de sa prédication et le chemin que l’Église doit sans cesse retrouver pour s’engager dans la véritable dynamique de l’Évangile. Puissent nos communautés s’en souvenir et, en le mettant en pratique, faire resplendir cette unité qui attire à Christ tous ceux qui regardent l’Église ! Lorsque, par amour, les croyants acceptent de brider leur propre liberté pour servir la communion, le monde découvre dans l’Église une lumière de paix et de guérison.
Finalement, que ce soit au temps de Paul ou à notre époque, l’appel de l’Évangile reste inchangé. Au lieu de critiquer, accueillons-nous ; jouissons de la liberté en Christ, mais avec la prudence de ne pas faire chuter nos frères ; portons une attention particulière aux plus faibles et ouvrons grand nos portes aux « étrangers ». Telle est la sainteté véritable qui distingue l’Église. C’est ainsi qu’on se prépare à répondre de sa foi devant le tribunal de Dieu. En vivant cette communauté de l’« amour et de la paix », nous goûtons réellement à la grâce du Royaume, et l’Église devient le canal par lequel le salut s’étend aussi bien aux Juifs qu’aux païens. Pour le pasteur David Jang, comme pour Paul, il est urgent de restaurer d’abord l’harmonie et l’accueil mutuel dans l’Église. Car c’est précisément là le cœur de l’Évangile, et la clé de toute œuvre fructueuse dans l’Église.
« N’ayez plus de critique les uns envers les autres, mais acceptez-vous dans le Seigneur » (Rm 14) ; « Ne placez pas d’obstacle devant votre frère » (Rm 14.13ss) ; « Portez la faiblesse de l’autre et accueillez celui qui vient d’ailleurs » (Rm 15) : ces exhortations forment un triptyque indissociable. Certes, nous ne pourrons jamais éviter complètement tous les différends, mais l’esprit de l’Évangile interdit de les résoudre par la surenchère ou la division. Le Nouveau Testament tout entier met en avant la communion et l’entraide réciproques comme l’ADN de l’Église. Puisse chaque Église, aujourd’hui, revisiter cette leçon et l’adapter à son contexte, afin que « ceux du dehors » puissent dire : « Vraiment, Dieu est au milieu d’eux ! » (cf. 1 Co 14.25). Car lorsque l’Église ne s’intéresse plus uniquement à la satisfaction de chacun, mais est prête à restreindre sa liberté pour l’édification commune, le monde peut voir la manifestation de la réconciliation et de la guérison.
En définitive, le message demeure inchangé à travers les siècles : sans cesse, l’Évangile nous appelle à renoncer à la critique pour l’accueil, à mettre notre liberté au service de l’amour, et à prendre soin des plus faibles comme des étrangers. Voilà ce qu’implique la conscience que « nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu ». Et c’est ainsi que l’Église fait l’expérience vivante de la « justice, de la paix et de la joie » : non pas dans la polémique ou la scission, mais dans la communion et la joie partagées. Comme le souligne sans cesse le pasteur David Jang, c’est la quintessence de l’Évangile, le socle et la fin de tout ministère véritable.
www.davidjang.org